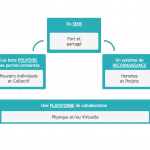La co-construction dans l’univers théorique des organisations
Au regard de l’histoire théorique des organisations, la co-construction bénéficie d’un siècle de recherches et emprunte aux différents courants de la discipline. Sa principale originalité consiste à cumuler ces approches théoriques et à utiliser l’intérêt individuel comme levier stratégique pour mettre en synergie l’ensemble des intérêts en présence.
Un nouveau champ de recherche
La théorie des organisations est une théorie récente qui est née au début du vingtième siècle suite aux efforts déployés par certains chefs d’entreprises – comme Taylor et Fayol – pour formaliser conceptuellement leur pratique et fournir un cadre théorique au gouvernement des entreprises. Elle s’est peu à peu constituée en discipline scientifique autonome rassemblant des chercheurs venus des différentes sciences humaines (psychologues, psychosociologues, sociologues, économistes, juristes, historiens, spécialistes du management) et a progressivement étendu ses investigations à l’ensemble des organisations.
Schématiquement, on peut distinguer trois types d’approches théoriques en fonction du sens donné à la notion d’organisation.
- Une première approche dite classique consiste à penser l’organisation comme une fonction à construire à partir de principes rationnels : le principe hiérarchique, le principe de l’unité de commandement, le principe de l’exception, le principe de l’éventail de subordination et le principe de la spécialisation organisationnelle (1)
- Une seconde approche dite normative interroge l’efficience des organisations, c’est-à-dire la capacité d’un collectif humain à coopérer efficacement.
- Enfin, une troisième approche se concentre sur la notion d’action collective et interroge le rapport entre l’organisation et l’action.
Un kaléidoscope de théories…
Ces théories ne représentent pas un corpus unifié mais un véritable kaléidoscope où les différences méthodologiques sont flagrantes : clivage entre l’approche positiviste et l’approche constructiviste ; entre holisme et individualisme théorique ; entre méthode déductive et inductive. Néanmoins, ces clivages constituent simplement différentes perspectives sur une même réalité et le meilleur compromis consiste sans doute à cumuler les approches afin de parvenir à une « description épaisse », comme le propose l’anthropologue Clifford Geertz – Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, PUF, 1986.
C’est précisément le parti-pris de la co-construction : cumuler les approches théoriques, plutôt que de s’interdire – par avance et par dogmatisme – certaines solutions possibles. Par conséquent, si l’on veut retracer l’univers théorique depuis lequel émerge la stratégie de la co-construction, il est nécessaire de présenter succinctement les principales découvertes de la théorie des organisations.
C’est le parti-pris de la co-construction : cumuler les approches théoriques, plutôt que de s’interdire – par avance et par dogmatisme – certaines solutions possibles.
L’école de la contingence
La découverte de la singularité des organisations
On parle d’école de la contingence pour désigner cette posture de recherche qui consiste à abandonner l’idée d’un modèle explicatif universel. Il s’agit désormais de prendre en compte la singularité des organisations, en distinguant différents facteurs de contingence : la taille de l’organisation, son histoire, sa technologie et son environnement. Ces facteurs de contingence serviront ensuite de marqueurs pour établir des typologies plus ou moins pertinentes.
C’est l’historien américain Alfred Chandler qui est considéré comme le fondateur de ce courant (Strategy and Structure, 1962 ; traduit en français en 1989 : Stratégies et structures de l’entrepris’). En décrivant la naissance d’une grande entreprise – qu’il définit comme un « récipient de connaissances » –, il met en valeur le rôle central joué par les dirigeants, insiste sur les capacités innovantes des grandes structures et anticipe la première théorie évolutionniste des organisations, c’est-à-dire l’idée selon laquelle le comportement d’une organisation est construit principalement sur des routines (Cyert et March, A theory behaviorist of the firm, 1963). Parce que les routines constituent en quelque sorte l’architecture inconsciente de l’organisation, elles produisent un répertoire de réponses qui annule la marge de décision des acteurs. On retrouve cette vision déterministe dans la théorie dite de l’écologie des populations qui analyse le rapport d’adéquation entre une organisation et son environnement.
Dans les années 60, les chercheurs du Tavistock Institute, Emery et Trist, approfondissent la notion d’environnement qu’ils définissent comme une configuration d’organisations liées entre elles, pour montrer que les entreprises sont insérées dans des trames causales complexes qui rendent leurs actions difficilement prévisibles. Ce travail précurseur déconstruit l’idée d’une entreprise isolée qui s’adapte à son environnement et anticipe l’idée qu’une organisation est en réalité un réseau d’interactions extrêmement complexe.
A terme, ce double postulat de la singularité des organisations et de leur insertion dans un écosystème complexe constituera en quelque sorte le préambule méthodologique de la co-construction, puisqu’il s’agira de produire un diagnostic singulier capable d’identifier l’ensemble des parties prenantes d’un projet et d’évaluer la nature et la qualité des relations existant entre ces parties.
C’est Charles Perrow qui est aujourd’hui considéré comme le chef de file de l’école de la contingence. Non seulement il théorise à partir de l’ensemble des travaux de recherches antérieurs, mais il découvre l’existence d’une extrême variété d’organisations et construit progressivement une matrice de modèles théoriques qui va connaître un grand succès.
Désormais, l’organisation est pensée comme un système contingent d’interactions individuelles qui convertit des stimuli en réponses : « En croisant la variable stimulus (stable, instable) avec la variable réponse (réponses connues parce qu’un répertoire de réponses existe, réponses à trouver parce qu’un répertoire de réponses n’existe pas), Perrow battit une matrice de modèles technologiques qui permet d’expliquer précisément la variété des modèles organisationnels. Cette matrice sera largement diffusée par la suite car cette analyse peut s’appliquer aux matériaux physiques ou à des informations à transformer (des barres à laminer en tôle, des demandes de prêts bancaires à transformer en prêts à accorder, un cahier des charges à transformer en immeuble à bâtir, etc.) (1) ». Autrement dit, dès lors que l’on accepte l’idée suivant laquelle la structure d’une organisation commande les interactions humaines, il suffit de réformer la structure pour réformer le comportement des humains qui la composent.
L’organisation comme système contingent d’interactions individuelles – Charles Perrow
Perrow lui-même, à la fin de sa vie, contestera son intuition de départ pour affirmer que les organisations sont d’abord composées par des hommes dont le comportement n’est pas intégralement rationnel. Au final, les organisations ressemblent davantage à des « zones de marchandage », qu’à des systèmes rationnels de coopération. Par conséquent, si les organisations sont des zones conflictuelles qui mettent en jeu des relations asymétriques entre des acteurs, cela signifie que les solutions apportées au problème de l’efficience se trouvent totalement à réinventer et cela suppose que, désormais, « ce sont les sociologues des organisations qui doivent prendre le relai » (2).
Mais l’idée que les organisations ne soient pas des systèmes rationnels à construire mais des « zones de marchandage » – c’est-à-dire des zones instables de négociations entre des parties prenantes hétérogènes – est une idée partagée et largement amplifiée par la stratégie de la co-construction.
C’est précisément parce que l’organisation est pensée comme une zone complexe de compromis que l’introduction d’un sens personnalisé autour de l’objet à construire et l’animation d’une plateforme (physique ou virtuelle) d’interaction constituent des leviers stratégiques pour introduire la co-construction (Cf Document fondateur sur la co-construction).
Les organisations ressemblent davantage à des zones de marchandage, qu’à des systèmes rationnels de coopération…
l’école institutionnaliste
Chester Barnard ou l’art d’inciter et de faire accepter l’autorité
Une autre figure va jouer un rôle décisif dans la fondation des sciences de l’organisation : il s’agit de Chester Barnard, chef d’entreprise et auteur de The Functions of the Executive (1938). Son projet théorique – qui consiste à articuler les sciences juridiques, la théorie des organisations et l’économie – connaîtra une large postérité et donnera naissance à l’école institutionnaliste.
En cherchant à créer une synergie optimale entre les stratégies individuelles et les stratégies collectives, C. Barnard construit la première théorie du comportement coopératif, c’est-à-dire de la problématique qui se situe au centre de toute la littérature du management : « Une organisation ne peut réussir que si les membres de l’organisation qui y travaillent s’y retrouvent, cette proposition est l’intime conviction de Barnard, son programme de recherche (…) (3) ».
Suivant cette intuition, le chercheur va focaliser son attention sur deux facteurs internes décisifs de l’organisation : l’autorité et l’incitation. Il construit le concept de zone d’indifférence pour désigner une situation où le conflit n’est dans l’intérêt de personne et le concept de zone acceptable, pour signifier que l’autorité doit être reconnue comme légitime par ceux qui la subissent pour être acceptée. « L’art de commander n’est donc plus l’art de se faire obéir (Fayol), mais l’art de faire accepter l’autorité » (4). Enfin, en termes d’incitation, Barnard propose un modèle proportionné entre la contribution de l’acteur et sa rétribution, modèle qui est encore utilisé aujourd’hui dans les diagnostics effectués sur les organisations.
L’école systémique
L’organisation comme sous-système feuilleté multidimensionnel
Une seconde école dite systémique doit son origine aux recherches biologiques (menées dans les années 40 sur la différenciation et la complexification de l’embryon humain) et repose sur une explication fonctionnelle des institutions, c’est-à-dire une explication qui cherche à prédire le comportement d’un système en fonction de sa finalité et de son environnement.
Sous l’impulsion du biologiste Ludwig von Bertalanffy [General System Theory, 1968], cette école va s’efforcer de construire une théorie générale des systèmes capable de s’appliquer à l’ensemble des sciences – y compris les sciences naissantes que représentent la cybernétique, la théorie de l’information [Shannon, 1948], la théorie des jeux [Morgenstern et Neumann, 1944] et la théorie de la décision (5). Dans tous les secteurs du savoir, l’approche systémique considère la complexité d’une organisation comme un entrelacement finalisé de réactions dont le modèle descriptif doit être construit (6).
Cela signifie qu’une organisation est désormais pensée comme un système feuilleté multidimensionnel [Broussard, 2004] qui met en jeu un ensemble de systèmes connexes. Cette nouvelle approche va notamment permettre d’analyser le niveau d’autonomie d’une organisation, c’est-à-dire son niveau de vulnérabilité face à des variables extérieures provenant d’autres systèmes, et elle donnera naissance à la notion de système d’action, élaborée par les deux fondateurs de la sociologie des organisations : James March et Herbert Simon [Organizations, 1958]. Selon Michel Crozier, qui est l’importateur français de ces travaux, ces deux auteurs sont les premiers à « mettre en évidence le rôle joué par l’incertitude dans sa capacité à modifier les relations entre acteurs » (7), mais ils mettent trop l’accent sur les capacités décisionnelles des acteurs et n’insistent pas assez sur les effets de pouvoir à l’intérieur des organisations. La notion de système sera utilisée pour montrer que – derrière l’apparent désordre des stratégies individuelles – il existe un ordre systémique d’actions que le chercheur doit être capable de décrypter (analyse stratégique). Enfin, on parle aujourd’hui de crise systémique, pour désigner l’enchevêtrement des niveaux de réalité et l’interdépendance des écosystèmes (biologiques, sociaux, économiques, juridiques et politiques).
L’école comportementale
L’organisation comme système instable de décisions
Sous l’impulsion conjointe de James March et Herbert Simon, une troisième école dite comportementale concentre ses recherches sur les phénomènes (individuels et collectifs) de décision.
En cherchant à construire une base scientifique de l’efficacité organisationnelle, Simon analyse le comportement d’une organisation comme s’il s’agissait d’un être vivant et il critique la théorie du choix rationnel en montrant que la rationalité d’une décision est toujours limitée et relative. Quant à March, il poursuivra les recherches entreprises par Simon en démontrant que les préférences des acteurs sont instables et influencées par leur environnement et il décrira les organisations comme des « flux de problèmes, de solutions d’opportunités de choix et de participants » ou les « flux se rencontrent de façon aléatoire ». En somme, l’école comportementale s’attache à montrer que « le processus de décision est une activité fortement contextualisée, ritualisée et soumise à un processus d’interprétation » (8).
L’école actionnelle
L’organisation comme système d’action collectif
A côté des trois paradigmes précédemment cités – contingence, représentation et décision –, un nouveau paradigme va progressivement faire son apparition : le paradigme actionnel.
Par exemple, Argyris et Schön vont distinguer deux sortes de théories de l’action – celle revendiquée et celle réellement utilisée par les acteurs au moment de l’action – afin de montrer que l’apprentissage d’une organisation n’est possible qu’en l’absence de routines défensives (9). La théorie de l’action ne porte pas directement sur l’organisation, mais elle concentre son attention sur l’organisant et se demande ce que signifie pour lui l’action collective. Désormais, l’organisation est pensée comme « un système d’action collectif, reposant sur la division du travail et le partage des ressources, permettant d’articuler des actions individuelles dans des processus organisés socialement d’action collective, pour produire des résultats appréciables socialement (…) (10) ».
Dans cette perspective, Friedberg revendiquera le passage d’une sociologie des organisations à une sociologie de l’action organisée (11), c’est-à-dire une sociologie qui s’intéresse avant tout à la production d’un comportement en milieu social.
Enfin, on note également un regain d’attention pour le travail de Michel Foucault, pour penser autrement – c’est-à-dire de façon non moralisante – les rapports entre le souci de soi et le souci de la gouvernance, avec la naissance d’un nouveau courant de recherches autour de la notion de « gouvernementabilité » [Hatchuel, Pezet, Starkey et Lenay, 2005] (12).
La co-construction ?
cumuler les approches théoriques et utiliser l’intérêt individuel comme un levier stratégique
À l’heure actuelle, on observe la naissance de trois courants nouveaux en théorie des organisations : le courant institutionnaliste, qui interroge l’influence des institutions sur le comportement des acteurs ; le courant anthropologique, qui insiste sur l’importance des déterminations culturelles, notamment dans la définition de « l’estime de soi » ; et un troisième courant, qui se constitue progressivement autour de la problématique de l’action responsable, pour interroger la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
Au regard de ces nouvelles tendances, on peut considérer que la stratégie de la co-construction se situe au point de convergence et de pertinence de l’ensemble des écoles et des courants.
- Elle partage l’idée que chaque organisation est singulière et nécessite un diagnostic et une stratégie différenciés (facteur de contingence)
- elle appréhende l’organisation comme un sous-système complexe d’interactions inscrit dans un système complexe plus vaste (facteur systémique)
- Elle partage également la conviction anthropologique que la signification de l’action à accomplir et l’incitation (matérielle et immatérielle) constituent des facteurs décisifs d’implication et de réussite d’une action individuelle et collective (facteur anthropologique et institutionnaliste)
En intégrant les facteurs déterminants mis en évidence par la théorie et la pratique des organisations – facteurs de contingence, de système, de culture et de comportement – la stratégie de la co-construction cherche ainsi à faire fructifier une science disparate dont les fondements et la méthode ne sont pas encore tirés au clair.
La seconde originalité stratégique de la co-construction – en théorie comme en pratique – consiste à utiliser l’intérêt individuel comme un levier stratégique pour mettre en synergie l’ensemble des intérêts en présence (c’est-à-dire l’intérêt souverain de l’organisation, la somme des intérêts particuliers des acteurs, et l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes vitales pour l’organisation). Quelle que soit la nature de l’organisation concernée, l’objectif méthodologique consiste à prendre appui sur l’ambition personnelle des acteurs pour produire une situation d’implication et d’efficacité maximales pendant la construction collective d’un objet complexe. Par conséquent, il s’agit de produire une véritable synergie entre l’ensemble des parties prenantes d’une construction, c’est-à-dire de réussir l’intégration de ressources potentiellement inexploitées et l’implication d’acteurs potentiellement démotivés ou exclus d’un processus de décision, d’invention ou d’action.
Emmanuel Nardon
Philosophe, écrivain, son travail de recherche se situe à l’intersection de la philosophie, de l’anthropologie et de la politique.
Contacter l’auteur
- Jean-Michel Saussois, Théorie des organisations, Éditions de la découverte, 2007, p. 44-45
- Ibid. p. 47
- Ibid., p. 48
- Ibid., p. 49
- Ibid., p. 54
- Ibid., p.55
- Ibid., p. 59
- Ibid., p. 69-70.
- Ibid., p. 75-78
- Ibid., p. 88
- Ibid. p. 90
- Ibid., p. 93